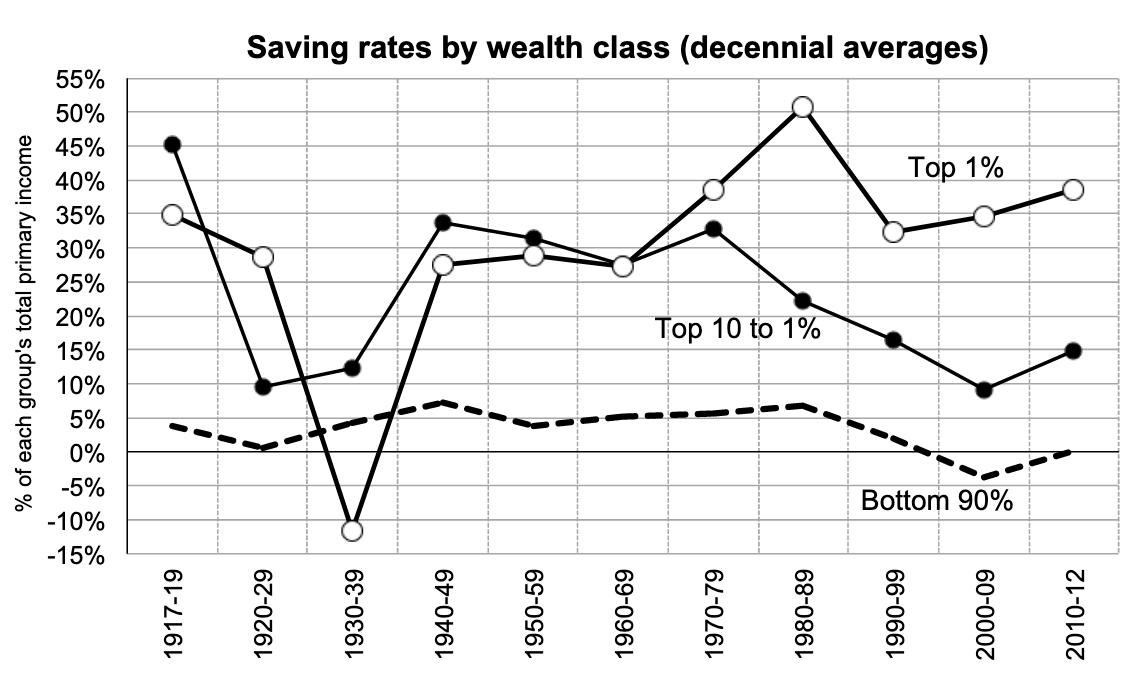Plus les allocations sont élevées, plus les salaires doivent devenir attractifs. C’est en cherchant du travail que les chômeurs en font baisser le coût.
La création des allocations de chômage a été justifiée par l’allègement des coûts de rotation du personnel (lequel a pu trouver un autre emploi après que l’on ait souhaité temporairement s’en séparer, et qui, dans la crainte du besoin, est toujours à la recherche d’une meilleure situation) et par leur impact positif sur le cercle vicieux baisse de la consommation – réduction des investissements. Cette protection sociale ne fait son entrée en scène aux USA qu’en 1935, après trois années de difficultés sérieuses pour l’industrie américaine. Dans les années 1970 [et sans doute encore après], son envergure y est encore trop modeste pour se targuer de son efficacité. Aujourd’hui, on défend encore l’existence de l’assurance-chômage sur la base de son apport à la productivité, avoir le temps de choisir un emploi qui paye bien étant censé faciliter l’accès à la main d’œuvre pour les secteurs plus productifs➤.
Dans le secret du patronat – Jacques Cotta et Pascal Martin 2001 – Denis Gautier-Sauvagnac (UIMM, MEDEF, UNEDIC)
En 1994, la Federal Reserve (la banque centrale des États-Unis) essaye un « atterrissage en douceur », c’est-à-dire une première tentative – historique – de monter progressivement les taux d’intérêt* pour accompagner une reprise de l’économie➤➤. Derrière la crainte officielle de l’inflation*, on suggère que la manœuvre vise peut-être à prévenir la diminution du chômage, laquelle réduit la concurrence entre les travailleurs et permet donc aux salaires de grimper➤, au détriment des profits… or ces derniers doivent être suffisants pour permettre l’investissement[1], les emprunts s’appuyant sur le capital disponible comme garantie. [Les profits bruts incluent la rémunération des services financiers, pas les profits nets.] Bon, c’est surtout vrai si les taux d’intérêt réels sont élevés… [C’est sans doute surtout l’incitation à investir qui manque si les profits ne sont pas au rendez-vous. On préférera peut-être précipiter la chute de la demande pour couler clients ou fournisseurs et procéder à une intégration verticale.]

Reticulárea, de Gertrud « Gego » Louise Goldschmidt, créé pour le musée des Beaux Arts de Caracas en 1969
Mais quels sont les effets à plus long terme d’une telle décision ? La baisse des investissements (auxquels on préfère des placements financiers contribuant aux bulles spéculatives) risque de ne pas jouer en faveur de la productivité du travail, que l’on affirme être une des clefs de la compression du niveau de chômage n’accélérant pas l’inflation[2], évalué à environ 5 % aux États-Unis et 10 % en France. Par ailleurs, ce taux de chômage dit “naturel” est suspecté de croître peu à peu en période de faible emploi : la représentation inaudible des chômeurs dans les négociations salariales et leur marginalisation progressive font s’éloigner les perspectives d’embauche, et les salariés sont moins concurrencés – ce qui rend l’embauche encore plus improbable pour les sans-emploi.
La pression sur les salaires est favorisée si l’on pousse énergiquement les chômeurs à chercher du travail [c’est un cercle vicieux : une baisse des salaires réels incite à faire plus d’heures, ce qui restreint l’accès à l’emploi – sauf si l’on considère que le gain procuré par le travail supplémentaire n’en vaut pas la peine]. Une méthode consiste à augmenter le différentiel entre les salaires et les allocations de chômage, raison pour laquelle le travail à temps partiel est considéré comme désincitatif[3]. En parallèle, un des objectifs de la Stratégie Européenne pour l’Emploi est de rehausser le taux d’emploi (le nombre de personnes au travail parmi celles en âge de travailler), par le repoussement de l’âge de départ en retraite, le travail des femmes ou celui des jeunes encore scolarisés, ce qui doit permettre d’embaucher sans pour autant diminuer le nombre de chômeurs[4].
Dès les débuts de l’industrialisation, en Angleterre, le chômage est une composante de la détermination des coûts salariaux. À cette époque, les propriétaires fonciers comprennent qu’en indexant leurs rentes sur l’inflation, ils peuvent tirer parti de la hausse du cours des matières premières causée par l’accroissement démographique. Transformant leurs champs cultivés en pâturages pour les moutons dont la laine est convoitée par l’industrie textile, et clôturant leurs terres, ils forcent les plus pauvres, comptant jusqu’alors sur les ressources communes, à rejoindre les rangs de l’armée de réserve des ouvriers. L’élite industrielle naissante voit bien sûr d’un mauvais oeil la montée du cours des matières premières, mais d’un bien meilleur l’ouverture des frontières aux importations de ces mêmes matières. Une autre solution à l’inflation est la stabilisation démographique, le niveau des salaires constituant une variable d’ajustement de la reproduction[5].
Au début du 20ème siècle, les gains de productivité sont tels que les loisirs deviennent accessibles aux masses. La diminution du temps de travail est bien comprise comme un moyen de réduire le chômage et donc d’augmenter les salaires. Au travail, on cherche à éviter le zèle dont l’on craint l’effet sur les embauches[6]. Le taylorisme doit permettre d’éliminer cette “paresse”[7].
Notes
1. À noter que les actionnaires s’attribuent plus de dividendes au détriment des investissements en prévision d’une baisse de la demande liée à la hausse du chômage, accroissant davantage celui-ci ; au contraire, si le chômage baisse, les dividendes sont restreints pour favoriser l’investissement, ce qui forme un cercle vertueux pour l’embauche. [Il peut aussi s’agir d’une façon de prévenir la perte de l’accès aux ressources de l’entreprise si celle-ci devait peiner à rembourser ses créditeurs. Les dividendes payés sont autant de moyens d’investir supprimés. Baisser les dividendes permet d’obtenir des fonds sans grands frais, il s’agirait donc de les augmenter en prévision du besoin➤.] ![]() Des salaires plus élevés doivent stimuler l’investissement et donc l’embauche tant que la mécanisation n’est pas préférée. Quand les taux d’intérêt réels sont élevés, les activités peu rentables sont difficilement finançables, ce qui freine l’ensemble de l’économie et pousse d’une part les entreprises à augmenter les dividendes pour attirer le capital suffisant à l’obtention de crédits, d’autre part les capitaux à se porter sur d’autres actifs dont les dépôts bancaires, ayant pour effet de faire redescendre les taux d’intérêt et donc d’encourager les placements financiers à risque, lesquels peuvent former une bulle spéculative avec le concours des entreprises cherchant encore à étendre leur actionnariat.
Des salaires plus élevés doivent stimuler l’investissement et donc l’embauche tant que la mécanisation n’est pas préférée. Quand les taux d’intérêt réels sont élevés, les activités peu rentables sont difficilement finançables, ce qui freine l’ensemble de l’économie et pousse d’une part les entreprises à augmenter les dividendes pour attirer le capital suffisant à l’obtention de crédits, d’autre part les capitaux à se porter sur d’autres actifs dont les dépôts bancaires, ayant pour effet de faire redescendre les taux d’intérêt et donc d’encourager les placements financiers à risque, lesquels peuvent former une bulle spéculative avec le concours des entreprises cherchant encore à étendre leur actionnariat.
2. Le taux de chômage « naturel », « structurel », ou « d’équilibre »➤, est atteint quand les employeurs ne voient plus de raisons d’embaucher davantage de chômeurs qui leur rapportent autant en cherchant du travail sans en trouver. Si le taux de chômage est en-dessous, les coûts de production sont suffisamment élevés pour réduire l’investissement (à supposer que les capitaux trouvent de meilleurs rendements ailleurs) – et la préservation de la masse salariale facilite l’inflation. Si le taux de chômage est au-dessus du NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment), il devient rentable d’embaucher davantage (sauf à préférer éviter une baisse des prix). En dessous, on peut investir davantage tant que les capacités de production ne sont pas arrivées à saturation. Pour maintenir le taux de chômage à un niveau inférieur au NAIRU, on peut stimuler la demande par les dépenses fiscales. Les gains de productivité signifient moins de besoins en main d’œuvre pour un même niveau de production, et donc une plus faible part des salaires dans les coûts de production. Les augmentations de la rémunération du travail sont alors davantage supportables et peuvent mettre en difficulté la concurrence. On peut embaucher davantage, produire davantage, exporter davantage. Les gains de productivité aident par ailleurs à compenser l’accroissement de la masse monétaire dû à la transformation des crédits en dépôts, qui eux-mêmes permettent aux banques d’émettre d’autres crédits, et ainsi de suite (cette chaîne prend fin soit par manque de demande d’emprunts, soit par l’amputation à chaque maillon de la part venant constituer les réserves obligatoires). Les taux d’intérêt réels élevés, s’ils diminuent les investissements dans leur ensemble, laissent encore possibles les investissements à haut rendement, lesquels supposent des gains de productivité.
3. Christine Erhel et Hélène Zajdela, « Que reste-t-il de la théorie du chômage de Keynes? », L’Actualité économique, vol. 79, n°1-2, 2003, p. 174.
4. Raveaud Gilles, « Au cœur de la stratégie européenne pour l’emploi, le taux d’emploi », Education et sociétés, 2/2006 (n° 18), p. 17-33.
5. Jeremy Rifkin, La nouvelle société du coût marginal zéro, pp. 51-2 ; Neeson J.M., Collings Hannah. La clôture des terres et la société rurale britannique : une revue critique. In: Histoire, économie et société, 1999, 18e année, n°1. Terre et paysans. pp. 83-106 ; Beckett J.V., Sanconie Maïca. La propriété foncière en Angleterre aux XVIIe et XVIIIe siècles. In: Histoire, économie et société, 1999, 18e année, n°1. Terre et paysans. pp. 25-41 ; Michalina Vaughan et Margaret Scotford Archer, Social conflict and educational change in England and France 1789-1848, p. 67 ; Lallement Jérôme. Trois économistes face à la question sociale au XIXè siècle. In: Romantisme, 2006, n°133. Économie, économistes. pp. 48-58.
6. Benjamin Kline Hunnicutt, Work Without End. Abandoning Shorter Hours for the Right to Work ; Gary Cross, Time and Money, the making of consumer culture.
7. Raymond E. Callahan, Education and the cult of efficiency, pp. 28-9.