Avec la crise des années 1930, les politiques de plein-emploi sont attendues dans le monde entier. L’effort de guerre permettra l’utilisation intensive des capacités de production. À l’issue du conflit, les USA n’ont presque plus de concurrence industrielle [donc on ne cherche pas à être compétitif sur les prix et les salaires peuvent grimper], et le [presque] plein-emploi donne à l’économie américaine l’occasion de réduire le surplus d’épargne accumulé quand les biens de consommation n’étaient pas disponibles. ![]() ➤ La pénurie de dollars est un moyen de faire pression sur les pays étrangers, notamment pour qu’ils soient poussés à exporter leurs matières premières vers les États-Unis – ce que la Grande-Bretagne, maîtresse du bloc sterling, n’apprécie que modérément. En 1948, on commence à s’attendre à ce que l’inflation (possiblement liée à une demande de consommation qui ne peut être pleinement satisfaite par des capacités industrielles en phase d’adaptation à la demande civile) tourne en déflation➤. Après la guerre de Corée, qui force le Congrès américain à mettre fin au manque de billets verts (l’asphyxie de l’Europe est peut-être ainsi évitée puisqu’au même moment les prix des matières premières s’envolent – il ne s’agit pas d’un geste désintéressé si l’on prend en compte le frein mis à l’accumulation du capital du fait des dépenses militaires : lire Paul Mattick, Economics, politics and the age of inflation, pp. 20-1 et 68-9), on obtient en France l’indexation du salaire minimum sur l’inflation*. Le consensus sur la croissance est une possibilité de maintenir les profits même en situation de plein-emploi.
➤ La pénurie de dollars est un moyen de faire pression sur les pays étrangers, notamment pour qu’ils soient poussés à exporter leurs matières premières vers les États-Unis – ce que la Grande-Bretagne, maîtresse du bloc sterling, n’apprécie que modérément. En 1948, on commence à s’attendre à ce que l’inflation (possiblement liée à une demande de consommation qui ne peut être pleinement satisfaite par des capacités industrielles en phase d’adaptation à la demande civile) tourne en déflation➤. Après la guerre de Corée, qui force le Congrès américain à mettre fin au manque de billets verts (l’asphyxie de l’Europe est peut-être ainsi évitée puisqu’au même moment les prix des matières premières s’envolent – il ne s’agit pas d’un geste désintéressé si l’on prend en compte le frein mis à l’accumulation du capital du fait des dépenses militaires : lire Paul Mattick, Economics, politics and the age of inflation, pp. 20-1 et 68-9), on obtient en France l’indexation du salaire minimum sur l’inflation*. Le consensus sur la croissance est une possibilité de maintenir les profits même en situation de plein-emploi.
Tant que le taux de chômage reste faible, les salaires peuvent grimper, même s’il s’agit de conserver un niveau d’investissement suffisant pour garantir les embauches, et aussi une rémunération du capital adaptée à la quantité d’épargne afin de ne pas provoquer la hausse des taux d’intérêt. Sauf que la progressivité de l’impôt sur le revenu signifie que les salaires nets sont de plus en plus rognés à mesure que les salaires bruts montent. Si les exigences en matière de salaires nets cherchent simplement à se calquer sur la hausse de la productivité, l’inflation générée[1] fait que les salaires nets réels plafonnent toujours. L’augmentation de l’imposition sur la masse salariale a été conçue comme un moyen de réduire la demande de consommation afin d’allouer des ressources au « rattrapage ».
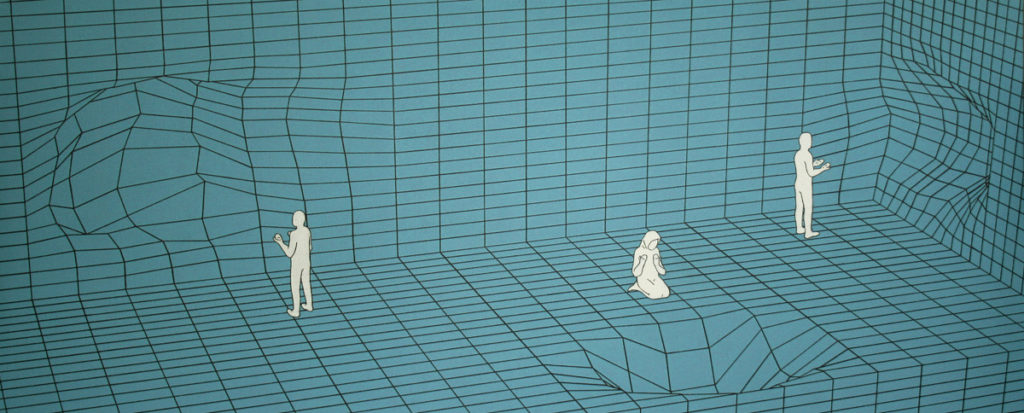
Erdem Ergaz 2006 – Metaphysics 01
Que reste-t-il comme option pour les syndicats ? Demander une baisse des prix plutôt qu’une hausse des salaires bruts d’un montant équivalent semble une bonne idée, bien qu’elle soit difficile à mettre en œuvre puisque chaque syndicat serait alors en position de négocier au bénéfice des travailleurs des autres secteurs. De plus, l’État, qui aurait tout à gagner à une baisse du prix de ses commandes sans diminution de ses revenus, se trouverait en possession d’un excédent budgétaire qui risquerait d’annuler l’effet de la déflation sur les salaires réels. Il pourrait donc s’agir de demander simultanément à la baisse des prix… une baisse des salaires bruts. Ceux-ci pourraient alors se soustraire à l’emprise du fisc, n’accordant ainsi plus à l’État un surplus de moyens, tandis que la hausse résultante du montant réel net des salaires fournirait à l’économie une demande suffisante pour favoriser l’embauche[2].
Mais à la fin des années 1960, alors que les valeurs de travail et de consommation sont remises en question, et que les questions environnementales commencent à prendre de l’importance (ouverture du Club de Rome en 1968 – qui publie en 1972 le Rapport sur les limites de la croissance, réunion Bilderberg de 1973 qui évoque à la fois la hausse à venir du prix du pétrole et les implications environnementales de son utilisation[3]), veut-on vraiment augmenter le pouvoir d’achat ? Un détail : les pollutions, entraînant une hausse de l’épargne nécessaire aux frais médicaux, réduisent la consommation domestique (voir Michael Pettis, The Great Rebalancing, pp. 48-50). [Pourtant la santé influe sur l’humeur➤ et donc possiblement sur la propension à consommer. Et si épargner rendait plus triste ? Le vieillissement de la population peut aussi expliquer la progression simultanée de l’épargne (pour la retraite) et des dépenses de santé, comme l’accroissement des inégalités (les riches épargnent davantage que les pauvres, et ces derniers ont des risques de voir leur santé décliner).] [Au fond il reste le problème de la déflation : alors que l’épargne trouve déjà relativement facilement à s’employer, favoriser la consommation aurait pour effet de faire monter des taux d’intérêt nominaux déjà élevés – et les taux réels seraient alors voués à grimper. L’investissement dans ces conditions risque de privilégier les rendements juteux davantage que le volume – par la mécanisation et au détriment de l’embauche.]
Notes
1. Les coûts de production évoluent avec les salaires bruts tandis que la demande de consommation suit les salaires nets, or la baisse des profits entraîne celle de l’investissement : si la production n’est pas à la hauteur de la demande, il y a de l’inflation. De plus, les hausses de productivité n’affectent pas tous les secteurs uniformément, et ceux laissés à la traîne sont enclins à augmenter leurs prix de vente pour compenser le relèvement des salaires. Au sein même des secteurs connaissant des gains de productivité, les entreprises n’ayant pas suivi immédiatement le mouvement deviennent moins compétitives et sont vouées à mettre la clef sous la porte – réduisant l’offre, à moins qu’elles n’investissent elles aussi dans de nouveaux équipements, augmentant alors la demande.
2. Cette solution a été énoncée par H.A. Turner dans Do trade unions cause inflation ?, ouvrage publié par l’Université de Cambridge en 1972. La première partie de la solution, la baisse des prix, fut proposée par le président du syndicat américain United Automobile Workers, Walter Reuther. Il est question des liens de ce dernier avec la CIA dans The Mighty Wurlitzer, de Hugh Wilford.
